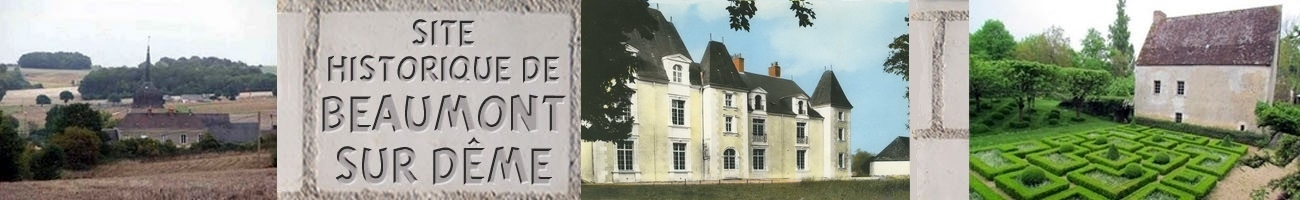
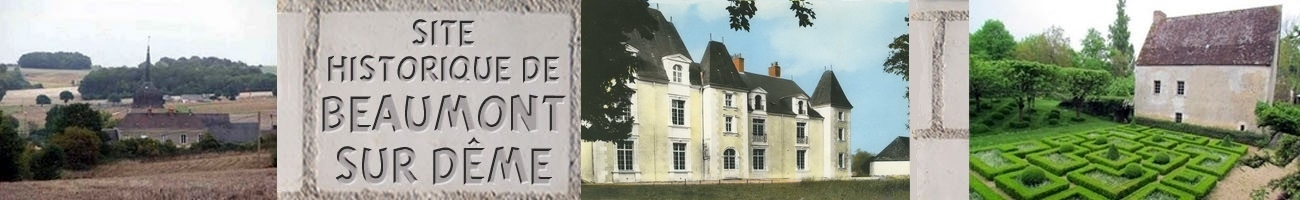

 Inscrite MH le 19 septembre 1950
Inscrite MH le 19 septembre 1950
 Historique
Historique
XII et XV siècles moellon enduit, pierre de taille, tuffeau et ardoise
L'église Saint-Pierre est mentionnée en 1002 lors d'un échange entre Gauzbert, abbé de Saint-Julien de Tours, et Robert de Château-Landon. Les rares et exceptionnels textes du Moyen Âge ne permettent pas de conclure définitivement sur l'établissement de l'église paroissiale, notamment à cause du fait que l'échange concerne Saint-Pierre, église paroissiale, alors que les moines possèdent ensuite Sainte-Marie, chapelle du prieuré simple de Vauboin, sans que l'on sache comment. Saint-Pierre a probablement été reconstruite autour de 1100. L'édifice actuel peut effectivement remonter au XIIe siècle (nef et portail occidental). Il fut probablement agrandi à partir de la fin du XVe siècle (cf. pignon à crochets de la nef supposant une nouvelle charpente), au XVIe siècle et jusqu'au XVIIe siècle (tour-clocher-chapelle 1, chapelle 2). Le deuxième quart du XVIIe siècle (date portée de 1646 ?) correspond à un important réaménagement intérieur de l'église, avec la mise en place d'un autel-retable -ensuite remplacé à la fin du XIXe siècle- présentant des statues en terre cuite. Il semble que le projet d'une troisième chapelle, côté sud, n'ait pas abouti (bas-côté inachevé). La sacristie conclut l'ensemble au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Une date portée de 1733 est gravée sur une pierre calcaire au bas du contrefort droit de la chapelle 2.
En 1748, la confrérie de Sainte-Agathe est adjugée pour 16 livres de cire blanche à plusieurs paroissiens (délivré le 11 février 1748 par le curé Deschelles). Le 8 décembre 1749, la frairie de Sainte-Barbe est mise à l'enchère et adjugée pour neuf livres et demie à plusieurs paroissiens. Le 12 février 1775, le bâton de sainte Agathe est mis à l'enchère et adjugé à MM. Sarcé, prêtre, vicaire de la paroisse, Leverrier, Lecerf, etc, à huit livres de cire. À noter qu'il y a plusieurs Agathe dans la famille du Juglart, présente au château du Fresne au XVIIIe siècle.
Au XIXe siècle, l'église est restaurée, réparée et remeublée à plusieurs reprises. Les travaux concernent majoritairement la couverture des différentes parties de l'église. Dès 1818, les pierres de la voûte de la chapelle centrale sont remplacées, la charpente est reconstruite avec une modification de pente à 45°, le pignon est démoli et réduit à la hauteur de la nouvelle charpente. La charpente de l'église est réparée. L'enduit sur la tour-clocher est refait. Douze arbres sont plantés devant l'église paroissiale. De 1897 à 1903, les travaux sont suivis par Auguste Ricordeau, architecte au Mans. En 1903 a lieu la réception définitive de travaux de réparation du clocher. D'autres travaux sont également engagés pour réparation de la toiture, ravalement, réfection. menés par Nivet, entrepreneur à Villedieu, Corbeau et Levieuge, maçons à Beaumont-La-Chartre.

 Architecture
Architecture
L'église est composée d'une nef, flanquée au sud d'une tour-clocher de plan quadrangulaire (à usage de chapelle) et d'une seconde chapelle, et d'un chœur à chevet plat en léger
décalage avec la nef, chœur auquel est accolée au sud une sacristie (cf. relevé de V. Desvigne). Six petits contreforts renforcent les la nef, la tour-clocher et la seconde chapelle,
sur laquelle on note à l'est une large baie obstruée et une zone d'arrachement correspondant au projet d'une troisième chapelle probablement jamais édifiée. La nef, le choeur,
la sacristie et la chapelle centrale sud sont couverts chacun d'un toit à longs pans, la tour-clocher est coiffée d'un toit à l'impériale.
Sur cette tour-clocher, une grosse gargouille à tête de lion permet l'évacuation des eaux pluviales tombant sur la noue entre les toitures de la nef et de la tour. L'église est construite en moellons de silex et de calcaire
enduits à chaux et à sable. Quelques gros blocs de grès constituent des soubassements.
Le portail occidental, cintré et orné, est remarquable mais la pierre de tuffeau s'effrite énormément et de plus en plus rapidement.
Les vestiges de trois cadrans solaires ornent les contreforts au sud. De nombreux graffiti, d'intérêts divers, ont été gravés sur l'église,
pendant des siècles. On relève notamment la date portée de 1646 au sud, qui pourrait correspondre à des travaux liés au réaménagement de l'église. À l'intérieur, la nef, sans bas-côtés,
est séparée du chœur par un arc-diaphragme. Elle est lambrissée en berceau brisé, alors que le chœur et la chapelle centrale sud sont voûtés d'arêtes.
La nef est ouverte au sud sur deux chapelles -la première étant au rez-de-chaussée de la tour-clocher. On note dans cette chapelle sud-ouest une pierre qui devait recevoir la cloche. La tour-clocher est desservie
par un escalier en vis en pierre calcaire logé dans une petite construction supplémentaire. Une porte a été obstruée au mur sud de la nef. La sacristie ouvre au mur sud du chœur.

 Peinture
Peinture Dans ce tableau de la Cène peinture sur bois de 50 X 250 cm, les tonalités de la peinture sont tout à la fois douces et lumineuses. Le mouvement des corps des Saints apôtres, groupés autour du Christ, est remarquable par la vie qui s'en dégage. Le tableau, dont l'origine est inconnue, a pu être réalisé dès la fin du XVIe siècle, au temps d'Henri III, d'après le vêtement, la coiffure et la barbe des protagonistes. On comparera l'iconographie à d'autres réalisations, dans les églises paroissiales de Courdemanche et de Coulongé en vallée du Loir.

Autre tableau remarquable cette Descente de croix. Le tableau, qui est la copie inversée d'un tableau de Paul Véronèse (1528-1588), aurait été offert au début du XVIIIe siècle par Anne-Nicolas Robert, marquis de La Chartre (par alliance ; il a épousé Catherine de Courtoux en 1697), pour la chapelle Sainte-Marie du prieuré de Vauboin à Beaumont-La-Chartre. À la Révolution, le prieuré est déclaré bien national et le tableau est déposé dans l'église paroissiale de Beaumont-La-Chartre.

 Sculpture et Ornement
Sculpture et Ornement
A gauche.
Cette statue en plâtre polychrome représente Saint Sébastien jeune Romain réputé pour sa beauté, martyrisé par ses propres archers, serait
le vrai patron des vignerons.Ceux de Beaumont sont les seuls du canton à continuer de s'y référer pour célébrer leur fête annuelle, les autres préférant le
patronage de Saint Vincent, parce que le nom de ce Saint Espagnol évoque le vin et sa couleur, le rouge sang.Cette fête se perpétue
dans presque toutes les communes du canton au mois de janvier avec banquets et dégustations dans les caves du pays.
A droite.
Lavabo liturgique orné d'une coquille.



Cette tête de Saint Jean en bois sculpté était également conservé dans l'église avant d'être volée
Toute personne ayant des renseignements à propos de cette sculpture est priée de contacter
la Mairie de Beaumont-sur-Dême au 02 43 44 43 17 d'avance merci.
 Vitraux
Vitraux



Vitrail de gauche.
Les verrières ont été exécutées par Ferdinand Hucher, au Mans [ultime représentant de la Fabrique de vitraux du Carmel du Mans], en 1899. La signature Hucher, Le Mans,
est portée au bas de la verrière de l'Immaculée Conception de Lourdes, don de madame Le Faucheux, propriétaire de la Marcellière à Marçon.
On y voit les armes suivantes accolées
Sous la couronne de Baron
D'argent à deux chevrons d'azur, chargé de trois merlettes de sable.
D'argent à la bande d'azur chargé de trois étoiles à six branches d'argent
Vitrail de droite.
Charles de Foucauld (1858-1916) est un officier de l'armée au passé tumultueux lorsqu'il retrouve la foi. Il
est ordonné prêtre en 1901 et s'installe à Beni Abbès dans le sud de l'Algérie puis à Tamanrasset, vivant en ermite, il cherche à fonder une
communauté de moines ou de laïcs qui n'aurait pas pour mission de convertir. Il échoue à mener ce projet à bien, et meurt assassiné. Après sa
mort cependant des groupes de prêtres et de laïcs se rassemblent et diffusent sa pensée. Ce vitrail qui lui rend hommage est
réalisé et placé en 1950 dans l'église de Beaumont sur Dême sur l'initiative d'un groupe de jeunes gens de la région.

 Accès à l'Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul
Accès à l'Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul

On monte à l'Eglise par la ruelle du Paradis

On descend de l'Eglise par le tertre de l'Enfer, à moins que ce ne soit le contraire ...
 Les curés de Beaumont-La-Chartre de 1594 au 20 octobre 1792 An I de la République.
Les curés de Beaumont-La-Chartre de 1594 au 20 octobre 1792 An I de la République.

| Prénoms, Noms | Dates |
|---|---|
| Noël Barré | 1594 |
| Marin Barré | 1627 |
| Urban (Urbain) Boutard | Décédé le 29/06/1650 |
| Pierre Houdry | 1662 |
| Pierre Censier dit Deslains | Décédé le 20/02/1670 |
| René Godefroy | 1694 |
| Nicolas Boutin | 1720 |
| Etienne Louis Deschelles | 1752 |
| Gervais Sarcé | 1783 |
| Gervais Sarcé (neveu du précédent) | 1792 |

